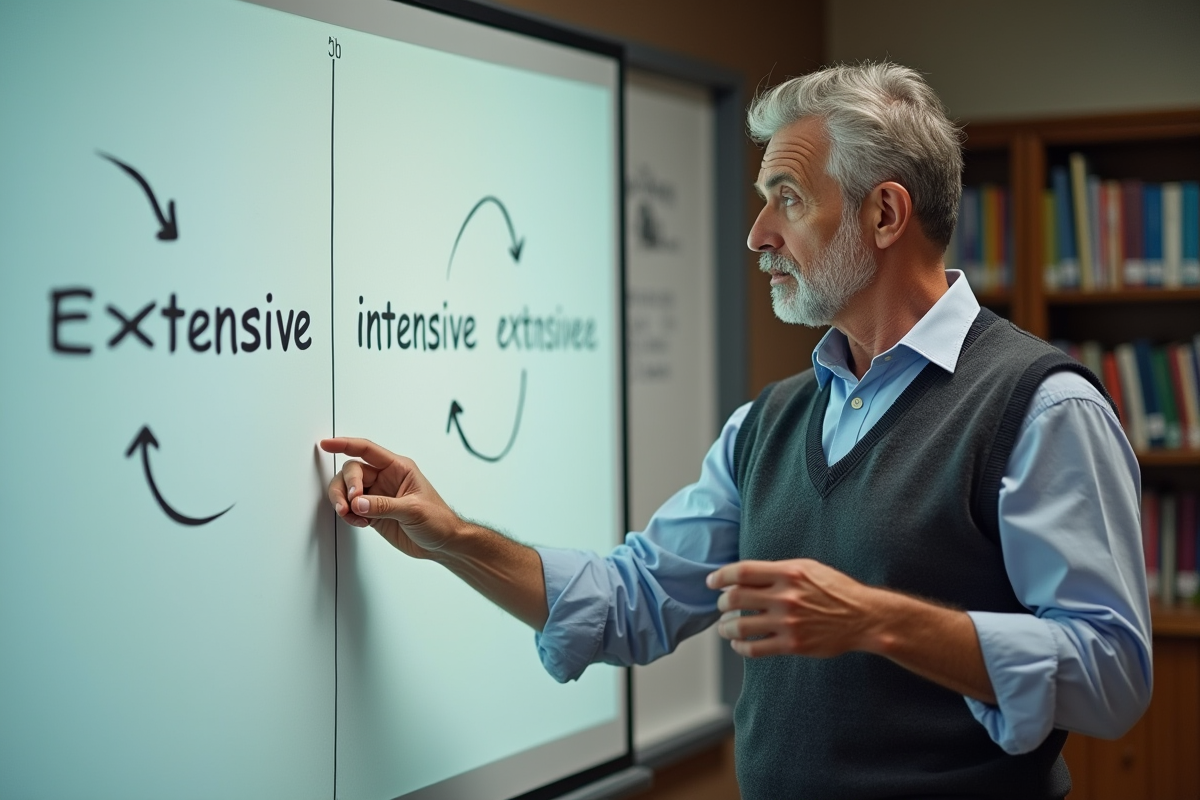86 % : c’est la part de la croissance mondiale attribuée au progrès technique sur le dernier demi-siècle, selon l’OCDE. Pourtant, l’équation qui sépare croissance extensive et intensive échappe encore à la majorité, alors qu’elle redessine, en profondeur, la trajectoire des nations.
Dans l’arène économique, il ne suffit pas de produire plus pour transformer durablement un pays. L’origine de cette croissance, le choix entre extension des ressources et élévation de la productivité, imprime sa marque sur l’avenir. Regardez deux nations dotées du même capital : l’une multiplie les bras et les machines, l’autre privilégie la montée en gamme ou l’innovation. Rapidement, leurs chemins divergent, emplois, salaires, exportations, tout s’en ressent. Cette mécanique, trop souvent ignorée, se révèle décisive pour démêler la réalité derrière un chiffre de croissance, et pour guider les politiques publiques.
Comprendre la croissance économique : définitions et enjeux
La croissance économique se définit comme l’augmentation continue de la production de biens et de services sur un territoire, généralement mesurée par le PIB. Les économistes s’accordent à distinguer deux moteurs : la croissance extensive et la croissance intensive. Dans le premier cas, il s’agit d’accroître la production en déployant plus de ressources : main-d’œuvre, capital, terres agricoles. Dans le second, l’accent est mis sur l’efficacité et l’innovation pour extraire davantage de valeur des ressources déjà en place.
Ce clivage ne se limite pas à l’économie. En physique et en chimie, la distinction entre variable extensive et variable intensive structure la compréhension des systèmes : une grandeur extensive dépend de la taille ou de la quantité de matière (comme l’énergie ou le volume), tandis qu’une grandeur intensive, température, pression, reste indépendante de l’échelle du système. Transposée à l’économie, cette approche offre une lecture précise du développement d’un pays.
Voici ce qui différencie concrètement ces deux formes de croissance :
- La croissance extensive accroît le volume total de production en ajoutant des facteurs tels que :
- plus de travailleurs,
- davantage de machines,
- une extension des surfaces agricoles exploitées.
- La croissance intensive élève le rendement de chaque facteur grâce à l’essor de la productivité, à la division du travail ou à des avancées technologiques.
La France, comme d’autres économies développées, a longtemps privilégié le modèle intensif pour améliorer le niveau de vie. Des indicateurs comme la productivité horaire ou le PIB par habitant éclairent cette réalité et révèlent la profondeur des transformations engagées. Saisir ces mécanismes permet de comprendre les trajectoires économiques et d’ajuster les politiques aux véritables enjeux.
Extensive ou intensive : quelles différences fondamentales ?
La ligne de partage entre extensive et intensive façonne aussi bien l’analyse des systèmes physiques que celle des choix économiques. Les grandeurs extensives, masse, volume, énergie, évoluent à mesure que la taille ou la quantité de matière augmente. Si l’on additionne deux volumes d’eau, le volume total double : ce caractère additif définit l’extensivité. En économie, la croissance extensive fonctionne de la même manière : augmenter la production en mobilisant plus de moyens, sans modifier la productivité propre de chaque facteur.
À l’opposé, les grandeurs intensives, température, pression, densité, ne changent pas lorsqu’un système homogène est découpé. Fractionner une plaque de métal ne modifie pas la température de chaque morceau. La croissance intensive suit cette logique : elle mise sur l’efficacité et le rendement, à travers des gains de productivité, la spécialisation ou l’innovation. Adam Smith, dès le XVIIIe siècle, insistait sur l’impact de la division du travail pour l’élévation du niveau de vie, bien au-delà de la simple addition de ressources.
Pour clarifier cette distinction, posons deux repères :
- Les grandeurs extensives sont additives : réunir deux systèmes revient à additionner leurs mesures.
- Les grandeurs intensives restent identiques dans toutes les portions d’un système homogène.
À noter que certaines propriétés, comme la surface d’un trou noir ou le carré du volume, échappent à cette classification binaire. En thermodynamique, chaque grandeur extensive se voit associée une grandeur intensive conjuguée : par exemple, la pression s’oppose au volume, la température à l’entropie. Ce jeu subtil de correspondances éclaire aussi la dynamique de la croissance économique, entre accumulation quantitative et progrès qualitatif.
Facteurs déterminants de chaque type de croissance
La dynamique de la croissance extensive repose avant tout sur l’augmentation des quantités mobilisées. Plusieurs leviers sont actionnés :
- une main-d’œuvre plus nombreuse,
- un accroissement du capital investi,
- l’extension de surfaces agricoles ou l’intensification de l’extraction de ressources naturelles.
L’exemple des Trente Glorieuses en France reste emblématique :
- la hausse du PIB s’expliquait par le recours massif à une main-d’œuvre en expansion et par des investissements importants dans l’outil de production.
Cependant, ce modèle atteint vite ses limites lorsque les ressources commencent à manquer ou que les rendements décroissent à l’usage.
À l’inverse, la croissance intensive parie sur une amélioration du rendement des facteurs déjà présents. Ici, le progrès technique occupe une place centrale. Robert Solow, prix Nobel d’économie, a montré que :
- l’essentiel de la croissance des économies avancées vient des gains de productivité, soit de l’innovation, de la montée en qualification, et de l’organisation du travail.
Joseph Schumpeter, pour sa part, met en avant la destruction créatrice :
- les innovations bouleversent les structures en place, stimulent l’efficacité et obligent à repenser les équilibres économiques.
Pour résumer ces deux dynamiques :
- Croissance extensive : mobilisation accrue de ressources, progression quantitative.
- Croissance intensive : progrès technique, formation, amélioration qualitative.
Le passage d’un modèle à l’autre ne va jamais de soi. Les obstacles sont nombreux :
- la raréfaction des ressources,
- la stagnation à long terme,
- ou l’épuisement du capital humain questionnent la pérennité de la croissance extensive.
La tendance actuelle, pour de nombreux pays, consiste à miser sur la croissance intensive, via l’éducation, la recherche, l’innovation, et la valorisation des compétences. Ce choix stratégique redéfinit la trajectoire de développement et pèse lourd dans la balance des politiques économiques modernes.
Des exemples concrets pour mieux saisir les nuances
La terminologie de la physique illustre parfaitement la différence entre grandeurs extensives et intensives. Le volume ou la masse augmentent proportionnellement à la taille du système : doublez la quantité de gaz dans un laboratoire, la masse et le volume suivent. Ce comportement « additif » signe la grandeur extensive.
À l’opposé, la température ou la pression ne se modifient pas en assemblant deux systèmes identiques. La température moyenne d’un gaz dépend de l’énergie par particule, pas de la quantité totale de matière. C’est le propre d’une grandeur intensive, indifférente à l’ampleur du système.
La thermodynamique exploite explicitement cette distinction :
- Le premier principe concerne l’énergie (extensive).
- Le principe zéro régit la température (intensive).
- Le deuxième principe s’applique à l’entropie (extensive).
Dans l’équation d’état du gaz parfait, P × V = nRT, la pression (P) et la température (T) sont intensives, tandis que le volume (V) et la quantité de matière (n) sont extensives.
Bien sûr, certaines quantités échappent à ce partage. Ainsi, la surface d’un trou noir, proportionnelle au carré de la masse, ne se range pas strictement dans une des deux catégories. Preuve que la nature aime brouiller les frontières, et que la réalité économique, elle aussi, se nourrit parfois de zones grises.